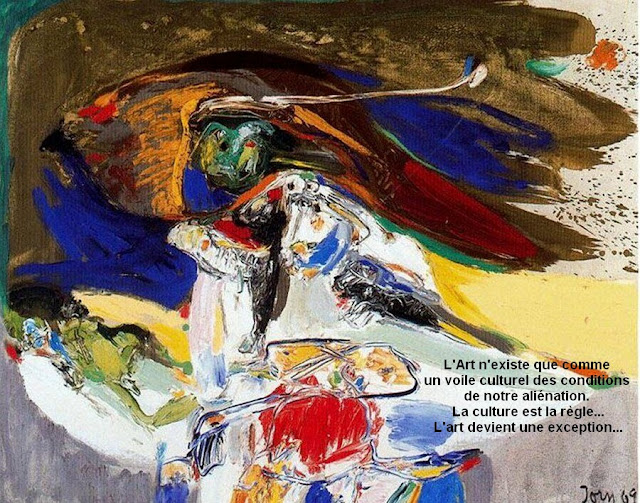« Je
ne suis qu’une originale, une rêveuse qui veut vivre loin du
monde, vivre la vie libre et nomade, pour essayer ensuite de dire ce
qu’elle a vu et peut-être de communiquer à quelques uns le
frisson mélancolique et charmé qu’elle ressent en face des
splendeurs tristes du Sahara. »
Le père, Tereneti
Antonoff, persécuté en
Russie pour ses convictions libertaires, sur le point d’être
exilé, avait fui en Algérie, cherchant une terre neuve, une patrie
d’élection où, sous un ciel clément, les hommes seraient moins
encroûtés de routine. Presque riche encore, il avait fondé une
ferme dans un coin riant du Tell, et là, entre ses champs et ses
livres, avait poursuivi son rêve d’humanité meilleure. Cependant,
il avait rencontré là des colons européens le même accueil
hostile et, peu à peu, il avait dû se retirer, se replier sur
lui-même. L’esprit de son fils unique, Andreï, déjà grand,
avait, de cette brusque transplantation, subi une perturbation
profonde. Tout le vague, tout
l’attirant mystère des horizons de feu étaient entrés, grisants,
en son âme prédestinée d’homme du Nord. Vivant à l’écart, ce
n’étaient point les hommes, c’était la terre d’Afrique
elle-même qui l’avait troublé, profondément.
- "Tu es un poète de
la nature",
lui disait son père avec
un sourire d’indulgence, comme j’ai été celui de l’humanité…
Nous nous complétons. Mais Andreï s’accommodait difficilement de
la vie cloîtrée qui suffisait à la lassitude de vivre du
vieillard. La hantise de l’inconnu, la nostalgie d’un ailleurs où
il se fût senti vivre harmoniquement, sans aspirations jamais
assouvies, l’étreignaient. Parfois, des mois entiers durant, il
n’ouvrait plus un livre, passant ses jours à errer dans les douars
bédouins, à s’asseoir avec les primitifs et les infirmes qui lui
rappelaient les moujiks de son pays, ceux que son père lui avait
appris à aimer et à comprendre. Le vieux philosophe ne condamnait
pas ces erreurs, cette vie nomade dont il comprenait le charme et la
salutaire influence, pour les avoir ressentis jadis.
–
"Tu as raison, va t’en aérer ton esprit… Va manger le pain noir
et participer à la misère et l’obscurité fraternellement…Ça
te fera du bien."
Et, peu à peu, Andreï
se laissa prendre pour jamais par la terre âpre et par la vie
bédouine. Son esprit s’alanguit, tout en restant subtil et
curieux. Sa hâte de vivre se ralentit et il escompta avec dédain la
vanité de tout effort violent, de toute activité dévorante. Quant,
ayant opté pour la nationalité française, il entra aux chasseurs
d’Afrique, et fut envoyé dans un poste optique du Sud, son ennui
et son dégoût d’être soldat firent place à la joie du voyage et
de la révélation brusque, flamboyante du Sud. Les splendeurs plus
douces de la lumière tellienne lui semblèrent pâles, là-bas, au
pays du silence et de l’aveuglant soleil. Un bordj surmonté d’une
haute tour carrée, sur une colline nue, au milieu d’un désert
d’une aridité effrayante…Pas une plante, pas un
arbre faisant tache sur la terre ocreuse, tourmentée, calcinée…Et, tous les jours, inexorablement, le même soleil dévorateur,
arrachant à la terre sa dernière humidité, lui interdisant,
jaloux, de vivre en dehors de ses jeux à lui, capricieux, aux heures
d’opale du matin et de pourpre dorée du soir. Là, Andreï comprit
le culte des humanités ancestrales pour les grands luminaires
célestes, pour le feu tout-puissant, générateur et tueur. Ce
bordj, sur la porte duquel les Joyeux ironiques avaient inscrit le
surnom de Éden Purée. Andreï l’aima. Entouré de quelques
camarades avides de retour et que, seule, l’absinthe consolait
d’être là, Andreï s’était isolé, pour mieux goûter le
processus de transformation heureuse qu’il sentait sourdre des
profondeurs de son être.
L’inquiétude, la
souffrance indéfinissable qui l’avaient torturé pendant les
années de son adolescence faisaient peu à peu place à une
mélancolie calme, douce, à un rêve continu. Il ne lisait plus, se
contentant de vivre… Il n’abandonnait pas sa résolution de
devenir un jour le poète de la terre aimée, de refléter avec son
âme plus sensitive de septentrional la tristesse, l’âpreté et la
splendeur de l’Afrique. Mais il se sentait incomplet encore, et
voulait son oeuvre parfaite… Et il
regardait, avec des yeux d’amoureux, lentement, laissant les
impressions s’accumuler tout naturellement, par petites couches
ténues. Et l’instinct inassouvi d’aimer voilait d’une
tristesse non sans charme cette existence toute de silence et de
rêverie. Andreï avait fini son année de service et il retourna,
plein de la nostalgie du Sud, auprès de son père, juste à temps
pour le voir tomber malade et mourir.
–" Reste toujours
sincère envers toi-même… Ne te plie pas à l’hypocrisie des
conventions, continue à vivre parmi les pauvres et à les aimer."
Tel fut le testament
moral que, dans une heure de lucidité que lui laissa la fièvre, lui
laissa son père. L’immense douleur de cette perte assombrit pour
longtemps l’horizon souriant de la vie d’Andreï. Le vieil homme
souriant et doux, le modeste savant ignoré qui lui avait appris à
aimer ce qui était beau, à être pitoyable et fraternel à toute
souffrance, l’éducateur qui avait veillé jalousement à ce
qu’aucune souillure n’effleurât l’âme de l’enfant et de
l’adolescent, qui n’avait point permis que l’hypocrisie sociale
imprimât son sceau déprimant sur son coeur, Térenti n’était
plus… Et Andreï se sentit tout seul et tout meurtri, au milieu des
hommes qu’il sentait hostiles ou indifférents. Mais l’obligation
où il se trouva de mettre en ordre les affaires de son père fut pour lui
une diversion salutaire. Puis se posa ce problème troublant : que
deviendrait-il ? Alors, Andreï se souvint de sa vie dans le Sud et
il la regretta. Et il songea :
- "Pourquoi ne pas retourner là-bas,
libre, pour toujours ?"
Il vendit la ferme,
transporta les livres de son père chez une vieille amie, réfugiée
polonaise exerçant l’humble profession de sage-femme à Oran, et,
toutes dettes payées, il eut quelques dizaines de mille francs pour
réaliser son projet. Il retourna s’agenouiller pieusement sur la
tombe sans croix du vieux philosophe, dans un petit cimetière, sur
une petite colline dominant la baie de Mostaganem… Et il partit.
Andreï songea qu’il suffisait de posséder le don précieux de
tristesse pour être heureux… Il était venu s’installer là,
dans l’ombre chaude des dattiers de Tamerna Djedida, dans le lit
salé de l’oued Rir’ souterrain. Il avait acheté quelques
palmiers, une source salpêtrée qui vivifiait de ses ruisselets
clairs le jardin et une petite maison cubique en toub rougeâtre. Le
bureau arabe dont dépend l’oasis avait bien cherché, par haine de
l’élément civil, surtout indépendant, à détourner Andreï de
son projet. On avait usé envers lui de tous les procédés, de la
persuasion rusée, de l’intimidation. Il s’était heurté à la
morgue, à la suffisance des galonnés improvisés administrateurs,
mais sa calme résolution avait vaincu leur résistance.
Il savait cependant que
le climat de cette région est meurtrier, que la fièvre y règne et
y tue même les indigènes. Mais n’avait-il pas séjourné de longs
mois dans le bas de cette vallée de l’oued Rir’, près de son
embouchure, dans le chott Mel’riri ? Il n’avait jamais été
malade et il résisterait… Il aimait ce pays mystérieux,
hallucinant, où toute la chimie cachée de la matière s’étalait
à fleur de terre, où l’eau iodée et salée dessinait de
capricieuses arabesques blanches sur les herbes frêles des séguia
murmurantes, ou teintait en rouge de rouille le bas des petits
murs en toub qui faisait des jardins un vrai labyrinthe obscur.
Partout, l’eau suintait, creusait des trous, des étangs profonds,
à la surface immobile et attirante, où se reflétaient les frondaisons graciles des
palmiers, les feuilles charnues des figuiers et les pommes rouges des
grenades… Puis, tout à coup, sans transition, le désert
s’ouvrait, plat, immense, d’une blancheur aveuglante. Le sol
spongieux se re–couvrait d’une mince couche de sel, avec de
larges lèpres d’humidité brune.
Tout cela flambait,
scintillait à l’infini, avec, très loin à l’horizon, de minces
taches noires qui étaient d’autres oasis. Et, à midi en été, le
mirage se jouait là, dans la plaine morte, d’où la bénédiction
de Dieu s’était retirée… En hiver, les chotts et les sebkas
s’emplissaient d’une eau claire, azurée ou laiteuse, et les
aspérités du sol formaient dans ces mers perfides des archipels
multicolores… Vêtu comme les indigènes, Andreï vivait de leur
vie, accepté d’eux et bientôt aimé, car il était sociable et
doux, et les guérissait presque toujours quand, malades, ils
venaient lui demander conseil.
– " Il deviendra
Musulman",
disaient-ils, l’ayant entendu répéter souvent que
Mohamed était un prophète, comme Jésus et comme Moïse, venus tous
pour indiquer aux hommes des voies meilleures. Les habitants
de Tamerna étaient des Rouara de race noire saharienne, une peuplade
taciturne, d’aspect sombre et de piété ardente, mêlée de
croyances fétichistes aux amulettes et aux morts.
La magie menaçante, le
silence du désert contrastant avecle mystère et le murmure vivant
des jardins inondés, avaient imprimé leur sceau sur l’esprit des
habitants et assombrissait chez eux la simplicité de l’Islam
monothéiste. Grands et maigres sous leurs vêtements flottants,
encapuchonnés, portant au cou de longs chapelets de bois jaune, les
Rouara se glissaient comme des fantômes dans l’enchevêtrement de
leurs jardins. Pour préserver leurs dattes de sortilèges, ils
attachaient des os fétiches aux régimes mûrissants. Ils ornaient
de grimaçantes figures les corniches et les coupoles ovoïdes de
leurs Koubba et de leurs mosquées pétries en toub. Aux coins
de leurs maisons semblables à des ruches, ils piquaient des cornes
noires de gazelles ou de chèvres… La nuit du jeudi au vendredi,
nuit fatidique, ils allumaient de petites lampes à huile près des
tombeaux disséminés dans la campagne. Ils subissaient la hantise de
l’au-delà, des choses de la nuit et de la mort.
Andreï ouvrait largement
son âme à toutes les croyances, n’en choisissait aucune, et ces
superstitions naïves ne le révoltaient point car, après tout, il y
discernait ce besoin de communier avec l’inconnu que lui-même
ressentait. Les femmes au teint obscur étaient belles, les métis
surtout, sous le costume compliqué des Sahariennes qui leur donne
l’air d’idoles anciennes. Drapées de voiles rouges ou bleus,
chargées d’or et d’argent, avec une coiffure large faite de
tresses relevées au long des joues, recouvrant les oreilles de
lourds anneaux, elles s’enveloppaient pour sortir d’une étoffe
bleue sombre qui éteignait l’éclat des bijoux. Leur charme
étrange, le mystère de leur regard attirait Andreï. Voluptueux,
mais recherchant les voluptés grisantes illuminées de la divine
lueur de l’illusion d’aimer, sans brutalité d’appétits,
Andreï n’avait jamais trouvé qu’une saveur très médiocre aux
assouvissements dépouillés de tout nimbe de rêve. Ce qui l’en
éloignait surtout, c’étaient leur banalité et la rancœur de
l’inévitable et immédiat réveil. Et il aimait à voir passer,
dans l’incendie du soir, les jeunes filles porteuses d’amphores,
s’en allant en longues théories au pas rythmé vers les fontaines
d’eau plus douce, aux confins du désert où le soleil mourant
allongeait leurs ombres sur le sol brûlé.
La vie d’Andreï
s’écoulait en une quiétude heureuse, monotone et sans ennui. Il
se levait à l’heure légère de l’aube pour goûter la
vivifiante fraîcheur de la brise discrète qui feuilletait les
palmes et les végétations aromatiques des jardins. Sur son cheval
qu’il aimait de sa tendresse apitoyée pour les animaux résignés
et confiants, il s’en allait dans le désert, poussant parfois vers
les oasis voisines, nombreuses dans la vallée, parées à cette
heure première de lueurs d’or et de carmin. Le grand espace libre
le grisait, l’air vierge dilatait sa poitrine et une grande joie
inconsciente rajeunissait son être, dissipant les langueurs de la
nuit chaude, succédant à l’embrasement du jour. Puis il rentrait
et errait dans les jardins, regardant les fellahs bronzés remuer la
boue rouge des cultures, enlever les dépôts salés obstruant les
séguia. C’était l’été, et les palmeraies lui
apparaissaient dans toute leur splendeur. Sous le dôme puissant des
palmes, les régimes de dattes pendaient, gonflés de sève,
richement colorés selon les espèces… Les uns, verts encore avec
une poussière argentée veloutant les fruits, les autres, jaune
paille, jaune d’or, orange, rouge vif ou pourprés, en une gamme
chaude de tons mats ou luisants. Longuement, Andreï se penchait sur
le ruissellement de l’eau jaillissant des dessous mystérieux
du fleuve invisible. Puis il rentrait dans la fraîcheur de sa
chambre fruste et s’étendait sur son lit en roseaux pour
s’abandonner à la mortelle et ensorcelante langueur de la sieste.
Quand l’ombre des
dattiers s’allongeait sur la terre excédée, Hadj Hafaïd, le
serviteur d’Andreï, le réveillait doucement, le conviant à la
volupté du bain. Parfois, repris de la nostalgie du travail, Andreï
écrivait et de temps en temps, à de longs intervalles, il rappelait
son souvenir aux chercheurs de littérature subtile par des contes du
pays de rêve où il mettait un peu de son âme et de sa vie.
Sur la route de Touggourt, non loin des grands cimetières
enclôturés, deux femmes vivaient, la vieille, Mahennia, et sa
fille, Saadia, que son mari avait répudiée, parce qu’on disait
dans le pays qu’elle et sa mère étaient sorcières. Elles
vivaient pauvrement du gain de la vieille, sage-femme et herboriste,
rebouteuse habile. On les respectait dans le pays et on les craignait
à cause des bruits qui avaient couru sur leurs sortilèges et de
l’inexplicable mort du mari de Saadia peu après son divorce. De
race métis presque arabe, les deux femmes se souvenaient de leurs
origines sémites et s’en faisaient gloire.
Saadia était belle et
son visage ovale, d’une couleur ombrée et chaude, était tout
empreint de la tristesse grave des yeux. Elle vivait modestement,
chez sa mère, et, malgré sa beauté, les Rouara superstitieux la
fuyaient. Andreï, au cours de ses promenades solitaires, la vit
plusieurs fois et la vieille, inquiète du succès du Roumi comme
guérisseur, tint à ne pas s’attirer son hostilité. Elle lui
offrit le café de l’hospitalité, ne lui cacha pas sa fille.
Saadia fut attentive à le servir, et silencieuse. Andreï savait les
bruits mystérieux qui couraient sur ces femmes et l’étrangeté de
leur existence l’avait attiré et charmé. La beauté de Saadia et
sa tristesse furent pour lui une délicieuse trouvaille et il revint
désormais souvent chez la vieille. Il désira Saadia et ne se
défendit pas contre son désir. Ne serait-ce pas un embellissement
de sa vie trop solitaire que l’amour de cette fille de mystère, et
une fusion plus entière de son âme avec celle de la terre élue,
par l’entremise d’une créature de la race autochtone ?
Voluptueusement, Andreï s’abandonna à la brûlure enivrante de
son désir. Saadia, impénétrable, ne trahissait pas sa pensée que
par le regard plus lourd par lequel elle achevait d’étreindre cet homme
blond, aux yeux gris, au visage de douceur et de rêve.
Toute la révolte de sa
jeunesse solitaire, tout son besoin d’être aimée, de ne pas
rester comme une fleur épanouie dans le désert muet, Saadia les
reporta sur ce seul homme qui ne la fuyait pas. Moins timide,
bientôt, elle lui parla, lui cita les noms des herbes séchées qui
pendaient en gerbes sous le toit de leur maison et leurs vertus ou
leurs poisons.
– "Ça, c’est le nanâ
odorant, dont le jus guérit les douleurs du ventre, et ça c’est
le chich gris dont la fumée arrête la toux."
Sa voix de poitrine,
vibrante, parfois saccadée, avait un accent étrange pour parler
cette langue arabe qu’Andreï possédait maintenant. D’autres
fois, Saadia lui nommait les bijoux qui la paraient. Un jour, pour la
mieux deviner, Andreï lui demanda de quoi était mort son mari.
– "Quand l’heure est
venue, nul ne saurait la retarder du temps qu’il faut pour cligner
de l’oeil… Et celui qui commet l’iniquité encourt la colère
de Dieu."
Une ombre passa dans le regard de Saadia. Un jour, il la
trouva seule au logis. Leur maison était isolée et voilée par le
rempart des palmiers. Elle lui sourit et l’invita à entrer quand
même.
– "Viendra-t-elle
bientôt, la mère ?"
– "Non, elle ne viendra
pas… Mais viens-tu ici pour elle seule qui est vieille et dont les
jours sont écoulés ?"
Et Andreï, dans la
douloureuse ivresse d’aimer, la regarda. Souriante, le regard
adouci, elle était debout devant lui, accueillante. Pour la première
fois, Andreï connut toute la volupté des sens qu’il avait
savamment préparée, l’embellissant de tout son rêve. Quand la
lune du soir emplit la chambre, Saadia le congédia, doucement, par
prudence…
– "Fais un détour… Je
ne sais si la vieille pardonnera. Il vaut mieux que je la sonde
d’abord."
Et Andreï s’en alla.
Le désert tout rouge brûlait et une ombre bleue s’étendait comme
un voile sous les palmiers dont les sommets s’allumaient
d’aigrettes de feu. Et Andreï s’arrêta, la poitrine oppressée,
en un immense élan de reconnaissance envers la Terre si belle et la
vie si bonne.
Isabelle
Eberhardt (17 février 1877 à Genève - 21 octobre 1904 à
Aïn-Sefra), Algérie). Née à Genève, Isabelle Eberhardt est
déclarée de père inconnu, sous le patronyme d'Eberhardt, nom de
jeune fille de sa mère. A 20 ans, Isabelle quitte Genève pour Böne,
dans l’Est constantinois. Elle fuit les Européens, décide de
vivre comme une nomade, loin de la civilisation des sédentaires. Ce
texte écrit en 1899 - elle a 22 ans est extrait de : Au
Pays des sables
(1re édition
sous le titre Contes et
souvenirs, 1925 )
2e édition
établie et préfacée par René Louis Doyon à Paris chez Fernand
Sorlot en 1944 - Reed : J. Losfeld, Paris, 2002